Combattre la désinformation d'État et préserver la souveraineté informationnelle : Enjeux et stratégies pour les pays africains
- Pierre Mob MOBENGO
- 25 mars
- 47 min de lecture
Combattre la désinformation d’État et préserver la souveraineté informationnelle : enjeux et stratégies pour les pays africains

Introduction
Les campagnes de désinformation orchestrées par des États sont devenues un outil géopolitique redoutable, pouvant déstabiliser des nations ciblées sans un seul coup de feu. Qu’il s’agisse de propagande guerre froide ou de manipulations virales sur les réseaux sociaux, les grandes puissances – États-Unis, URSS/Russie, France, Chine, entre autres – ont toutes recouru à l’information comme arme d’influence. Pour les pays qui en sont la cible, en particulier des États africains soucieux de leur souveraineté, la question cruciale est la suivante : comment se défendre face à ces ingérences informationnelles sans sombrer dans la censure ni la naïveté ?
Cet article propose une analyse rigoureuse et équilibrée du phénomène, évitant tout manichéisme. Il examine les stratégies de désinformation d’hier et d’aujourd’hui menées par diverses puissances (CIA, KGB, DGSE, etc.), puis se penche sur l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – comme étude de cas de la guerre de l’information contemporaine en Afrique. Enfin, il formule des recommandations concrètes (juridiques, diplomatiques, numériques, éducatives, médiatiques) afin de renforcer la souveraineté informationnelle des États africains. L’approche se veut analytique, critique mais impartiale, dans une perspective panafricaine visant à outiller les nations du continent face à la désinformation étrangère.
Panorama des campagnes de désinformation étatiques
Les États-Unis : de la propagande de la guerre froide aux opérations clandestines
Dès le début de la guerre froide, les États-Unis ont perçu l’information comme un champ de bataille décisif contre le bloc soviétique. La CIA (Central Intelligence Agency) a mené d’importantes campagnes d’influence et de propagande à travers le monde, souvent sous couvert d’organisations écrans. Dans les années 1950-60, l’Agence a financé ou créé des médias dans de nombreux pays pour y promouvoir des narratifs favorables à Washington. Par exemple, la CIA n’a pas hésité à créer de toutes pièces des journaux et agences de presse via des sociétés écrans, ou à investir dans des publications existantes afin d’en orienter la ligne éditoriale ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)). À Nairobi (Kenya), elle a fondé le East African Legal Digest comme couverture pour l’un de ses agents, tandis qu’aux États-Unis elle finançait des revues destinées aux étudiants asiatiques afin d’influencer subtilement les élites étrangères formées sur le sol américain ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)) ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)).
Washington a également massivement soutenu des radios de propagande anticommunistes comme Radio Free Europe et Radio Liberty pendant des décennies ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)). Officiellement présentées comme des médias d’information objective, ces stations étaient en réalité financées et guidées par la CIA via des comités écrans, diffusant vers l’Est des messages sélectionnés dans le but d’éroder l’influence soviétique ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)). La CIA craignait par ailleurs que ses opérations ne produisent un effet boomerang (le blowback), c’est-à-dire que ses fausses informations finissent par être reprises par inadvertance dans la presse américaine ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)). Cette préoccupation illustre bien que même la désinformation la mieux orchestrée peut contaminer l’espace informationnel du commanditaire.
Au-delà de la propagande médiatique, les États-Unis ont usé de campagnes de désinformation électorale pour influencer le cours politique de pays tiers. L’histoire a révélé qu’au Chili, en 1970-1973, la CIA a mené une vaste opération clandestine contre le gouvernement socialiste de Salvador Allende : après avoir financé la presse d’opposition, elle est allée jusqu’à fabriquer de faux documents accusant faussement des militants de gauche de comploter l’assassinat de généraux chiliens – de quoi justifier auprès de l’opinion la préparation d’un coup d’État militaire (Histoire de la CIA — Wikipédia). De même, au Brésil au début des années 1960, la CIA dépensa l’équivalent de 20 millions de dollars en actions de propagande et de soutien à des politiciens alliés afin d’empêcher le président João Goulart de consolider son pouvoir, ouvrant la voie au coup d’État de 1964 (Histoire de la CIA — Wikipédia). En Asie, elle manipula aussi des processus électoraux : aux Philippines, la CIA orchestra une campagne de désinformation pour faire élire Ramon Magsaysay en 1953, allant jusqu’à prévoir d’éliminer son opposant si nécessaire (Histoire de la CIA — Wikipédia) (Histoire de la CIA — Wikipédia). Ces exemples documentés démontrent que la démocratie de nombre de pays a pu être infléchie par la diffusion de fake news et de narratifs biaisés concoctés à Langley.
Il convient de noter toutefois que les États-Unis n’étaient pas seuls à pratiquer de telles méthodes – et ils ne le sont toujours pas. Face aux manipulations soviétiques, Washington a souvent justifié ses propres opérations comme un moindre mal, estimant répondre à la propagande hostile par une contre-propagande au service du « monde libre ». Néanmoins, du point de vue des États ciblés, l’ingérence informationnelle américaine – qu’elle prenne la forme de bulletins radio en langue locale, de rumeurs semées dans la presse, ou de campagnes numériques plus récentes – constitue bel et bien une atteinte à leur souveraineté narrative. Les exemples contemporains ne manquent pas, qu’on songe aux polémiques sur les armes de destruction massive en Irak en 2003 (information déformée au plus haut niveau pour justifier une invasion), ou aux révélations sur la surveillance massive de l’opinion via les réseaux sociaux. Dans une logique impartiale, il faut reconnaître que l’arsenal des stratégies de l’information fait partie intégrante de la panoplie de puissance américaine, au même titre que d’autres États.
URSS/Russie : des “mesures actives” soviétiques aux campagnes numériques du Kremlin
En face des États-Unis, l’URSS puis la Russie ont développé leurs propres méthodes de désinformation d’État, qualifiées pendant la guerre froide de “mesures actives” (aktivnyye meropriyatiya). Le KGB, puissant service de renseignement soviétique, disposait d’un département entier dédié à ces opérations clandestines visant à influencer l’opinion internationale. Forger de faux documents, répandre des rumeurs subversives, infiltrer des mouvements pacifistes ou des médias tiers : telles étaient les armes de Moscou pour discréditer ses adversaires occidentaux et gagner du terrain idéologique (La désinformation aux Etats Unis | INA). Dès les années 1960, le Politburo soviétique autorisa des campagnes visant à déstabiliser des dirigeants ou des pays jugés hostiles en fabriquant de toutes pièces des correspondances compromettantes. Ainsi, furent diffusées de fausses lettres attribuées à des responsables américains – par exemple une pseudo-lettre du président Reagan au roi d’Espagne Juan Carlos – dans le but de semer le trouble au sein des alliances occidentales (La désinformation aux Etats Unis | INA). L’objectif était clair : saper la crédibilité des États-Unis et fracturer leurs partenariats en faisant croire à des manigances, grâce à des falsifications suffisamment plausibles pour tromper la presse internationale.
L’un des cas les plus emblématiques fut l’opération INFEKTION, menée dans les années 1980 par le KGB en coopération avec la Stasi est-allemande. Cette vaste campagne de désinformation propagea dans de nombreux pays l’idée que le virus du SIDA avait été créé artificiellement par les services secrets américains (la CIA) dans le cadre d’expériences militaires. Les agents soviétiques s’appuyèrent sur un pseudo-rapport scientifique du biologiste Jakob Segal pour donner du crédit à cette théorie complotiste, et multiplièrent les insertions d’articles dans la presse étrangère pour lui donner une apparence de légitimité (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique) (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique). INFEKTION fut l’une des opérations anti-américaines les plus efficaces du bloc de l’Est : bien qu’exposée et finalement abandonnée en 1987 sous pression diplomatique américaine, elle a semé un doute tenace – pendant des années, une partie de l’opinion mondiale resta convaincue que Washington était à l’origine du VIH (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique) (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique). L’effet recherché par Moscou – entacher l’image des États-Unis et attiser la méfiance envers leurs activités scientifiques – avait en grande partie réussi, illustrant le pouvoir de la désinformation répétée dans un contexte de peur.
Sur le continent africain, le KGB n’a pas été en reste. Profitant des mouvements de décolonisation et des tensions Est-Ouest, il a infiltré nombre de pays nouvellement indépendants pour y asseoir l’influence soviétique. Comme le relate une étude historique, les espions du bloc de l’Est déployaient une imagination débordante : soutenir une tentative de coup d’État au Ghana, former des combattants africains sur les plages de Crimée, ou encore propager de fausses nouvelles en Algérie étaient autant d’actions entreprises pour servir les intérêts du Kremlin en Afrique (Revue de presse du 20 juillet 2023 – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). En 1964, par exemple, l’URSS aurait appuyé une conspiration pour renverser le président ghanéen Kwame Nkrumah (Opération Alex), tandis qu’ailleurs elle diffusait une propagande anti-occidentale calibrée selon les contextes locaux. La Russie de Vladimir Poutine n’a fait que reprendre ce flambeau, adaptant les “mesures actives” à l’ère numérique. Un ancien officier du KGB confie que « Poutine et les espions russes du FSB n’ont rien inventé » en la matière, s’inspirant largement des méthodes soviétiques éprouvées de désinformation et de déstabilisation (Revue de presse du 20 juillet 2023 – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique).
Depuis les années 2010, le Kremlin s’est illustré par des campagnes d’influence numériques sophistiquées exploitant les réseaux sociaux à l’échelle mondiale. On se souvient de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016 via de faux comptes Facebook et Twitter (l’Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, liée à l’oligarque Evgueni Prigojine, s’y est fait connaître). En Afrique, la Russie est même devenue le principal pourvoyeur de désinformation étrangère ces dernières années. D’après un recensement stratégique, Moscou a parrainé 80 campagnes de désinformation documentées en Afrique, visant plus de 22 pays – soit près de 40 % de toutes les campagnes recensées sur le continent (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique) (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). Ces opérations cherchent notamment à saper les processus démocratiques (Moscou a diffusé de la désinformation pour miner la démocratie dans au moins 19 pays africains) et à encourager des coups d’État en attisant des sentiments anti-occidentaux (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). La méthode russe contemporaine combine la création de contenus trompeurs (articles, vidéos, mèmes viraux), l’amplification par des “fermes de trolls” et bots en ligne, et le relais par des médias d’État comme Russia Today ou Sputnik diffusant en diverses langues.
Un exemple marquant de cette guerre informationnelle russo-occidentale en terrain africain a été révélé en 2020 : Facebook a annoncé avoir démantelé plusieurs réseaux de faux comptes qui opéraient en Afrique pour le compte, d’une part, de la Russie et, d’autre part, de la France (). Ces réseaux rivaux ciblaient notamment le public de la Centrafrique et du Mali, se livrant à une bataille d’influence sans merci en ligne (). L’enquête menée par Graphika et l’Observatoire Internet de Stanford a montré que le réseau lié à la Russie (piloté par des entités associées à Prigojine et à l’organisation paramilitaire Wagner) et celui lié à des individus proches de l’armée française se dénigraient mutuellement, allant jusqu’à dévoiler les manipulations adverses et à se caricaturer par dessins interposés (). C’est la première fois qu’une plateforme exposait ainsi deux opérations d’ingérence concurrentes, soulignant que l’Afrique est devenue un terrain de joute informationnelle entre puissances (). Si Facebook n’a pas attribué formellement ces activités aux gouvernements en question, la révélation de cette guerre de l’ombre en ligne a confirmé que la Russie, face aux pays occidentaux, utilise les médias sociaux africains pour gagner du crédit et contrer ses rivaux. Deux influenceurs numériques pro-russes de premier plan atteignaient à eux seuls 28 millions d’abonnés, leur contenu étant amplifié par des centaines de comptes liés à la nébuleuse Wagner (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique) (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). Après la mort de Prigojine en 2023, ces opérations ont été restructurées sous des appellations telles que Africa Corps ou Africa News Initiative, présumées pilotées par les services russes (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique).
En somme, de l’URSS à la Russie d’aujourd’hui, la palette va du forgage de lettres et rumeurs politiques au flooding numérique de groupes WhatsApp et pages Facebook. Le récit promu est souvent le même : mettre en avant la duplicité des Occidentaux, se poser en champion de la souveraineté des nations, et gagner l’appui des populations locales en jouant sur des ressentiments historiques (anti-colonialisme) ou des préoccupations identitaires (défense des valeurs traditionnelles, etc.). Nous verrons plus loin l’impact concret de ces techniques dans le cas du Sahel.
La France : de la Françafrique aux rivalités informationnelles contemporaines
Puissance ancienne sur le continent africain, la France a elle aussi un long passé d’ingérence informationnelle, bien que ses actions soient souvent moins documentées que celles des deux superpuissances de la guerre froide. Durant la période coloniale puis post-coloniale, Paris a déployé un vaste réseau d’influence – surnommé plus tard la Françafrique – combinant diplomatie parallèle, soutiens occultes à des régimes amis, opérations militaires clandestines, mais aussi contrôle des récits médiatiques. Les services français tels que la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) et auparavant le SDECE, ont mené des actions de propagande pour défendre les intérêts français dans les ex-colonies. Par exemple, dans les années 1960, la France a cherché à discréditer les leaders africains s’éloignant de son orbite en alimentant des campagnes de presse hostiles ou des rumeurs de complot. Au Cameroun, pendant la lutte de l’UPC contre le pouvoir soutenu par Paris, on a parlé de guerre psychologique où des tracts et messages radiophoniques visaient à présenter les indépendantistes comme des marionnettes communistes, justifiant ainsi la répression. De même, la crise de Biafra au Nigéria (1967-1970) a vu la France user d’une intense propagande humanitaire pro-sécession afin de concurrencer l’influence britannique et nigériane, via notamment l’iconographie de la famine (photos d’enfants affamés largement diffusées pour rallier l’opinion mondiale).
Dans les conflits plus récents, la France a parfois manipulé l’information pour préserver son image ou ses intérêts. Un exemple notoire est l’affaire du Rainbow Warrior en 1985 : après que des agents de la DGSE eurent saboté le navire écologiste de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, une campagne de désinformation fut initialement lancée pour détourner les soupçons (faux communiqués, fausses pistes) avant que la vérité n’éclate et ne contraigne Paris à admettre son rôle. Sur le théâtre africain, l’ère des réseaux sociaux a obligé la France à adapter ses stratégies. Confrontée à la montée des narratifs anti-français en Afrique francophone (accusant Paris de néocolonialisme, d’accaparement des ressources, ou de duplicité dans la lutte antiterroriste), la France a tenté de défendre sa version des faits via des canaux traditionnels (RFI, France 24) mais aussi, de manière plus contestée, via des opérations numériques discrètes.
En 2019-2020, comme mentionné, des investigations ont mis en lumière une tentative d’influence française sur Facebook visant des publics maliens et centrafricains, en réaction à l’activisme russe. Des comptes et pages anonymes promouvant une vision positive de l’action militaire française (Barkhane, Sangaris, etc.) et critiquant les exactions de Wagner ont été actifs, tout en dénigrant les comptes prorusses – une guerre de l’information souterraine à laquelle la France n’est pas habituée à être directement associée (). Facebook a supprimé ces comptes en même temps que les comptes russes adverses, indiquant qu’ils relevaient d’un comportement inauthentique coordonné. Bien que le gouvernement français n’ait pas été nommément accusé par Facebook, la coïncidence des thèmes et la connexion d’au moins certains opérateurs avec des entités proches de l’armée française laissent penser à une contre-offensive française dans le domaine cognitif (). En clair, face à une Russie très agressive en ligne, la France a pu juger nécessaire de mener, elle aussi, des actions clandestines sur les réseaux sociaux pour conserver son influence dans ses anciennes zones d’influence.
Par ailleurs, la France continue d’exercer une influence médiatique plus “officielle” en Afrique via ses médias internationaux et son réseau culturel. RFI (Radio France Internationale) et France 24 diffusent largement en français (et langues africaines) et constituent aux yeux de Paris des vecteurs légitimes d’information, mais aux yeux de certains gouvernements africains, ils peuvent apparaître comme des outils de soft power servant le narratif français. Cette ambiguïté a mené récemment à des tensions ouvertes : en 2022-2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger ont tour à tour suspendu ou expulsé RFI et France 24 de leur territoire, accusant ces médias de fausses nouvelles et de parti pris pro-occidental dans la couverture des crises locales. En réponse, les autorités françaises ont dénoncé une censure orchestrée par des juntes sous influence russe, pointant que ces régimes ne supportaient pas la liberté de la presse et préféraient diffuser leur propagande sans concurrence. On voit bien ici un choc frontal entre narratifs : pour Bamako, Ouagadougou ou Niamey, RFI diffuse de la désinformation dictée par Paris ; pour Paris, ce sont les dirigeants de transition sahéliens qui intoxiquent leur population avec l’aide de Moscou.
Un exemple récent illustre ce bras de fer : au Niger, la junte ayant pris le pouvoir en 2023 a brandi des documents attribués aux services secrets français (DGSE) pour accuser la France de chercher à saboter le nouveau régime. Ces documents classifiés, s’ils sont authentiques, suggèreraient que la DGSE a tenté d’exacerber des tensions internes au Niger et de pousser certains groupes à se rebeller contre la junte (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info). Leur fuite a été exploitée par les militaires nigériens pour dénoncer la « duplicité » française et justifier l’expulsion de l’ambassadeur de France. Paris, de son côté, a vigoureusement démenti et suspecte une manœuvre russe derrière cette affaire. En effet, présenter la France comme un « acteur hostile » extérieur sert les intérêts de la junte en ressoudant le sentiment national autour d’elle face à un bouc émissaire étranger (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info). Cette opération a tout l’air d’une campagne de propagande calculée pour discréditer la France non seulement au Niger mais dans l’ensemble du Sahel (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info). La conjonction de tels épisodes (documents exfiltrés, médias expulsés, manifestations orchestrées) montre que la France est désormais prise à partie dans une guerre de l’information où elle doit défendre sa réputation pied à pied, parfois face à des techniques qu’elle-même employait autrefois.
La Chine : propagande globalisée et lutte narrative sur le long terme
Le cas de la Chine mérite également attention, tant Pékin a intensifié ses opérations d’influence dans le monde entier au cours des deux dernières décennies. Longtemps centrée sur le contrôle interne de l’information (censure du web domestique, propagande du Parti communiste auprès de la population chinoise), la Chine déploie désormais une stratégie plus offensive à l’extérieur, cherchant à façonner les discours internationaux à son avantage et à contester l’hégémonie médiatique occidentale. Sa doctrine s’articule autour du concept de “guerre politique” incluant les Trois guerres : la guerre de l’opinion publique, la guerre psychologique et la guerre juridique (LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE CHINOISES). Il s’agit de gagner des batailles narratives sans combattre militairement, en modelant la perception globale de la Chine et de ses adversaires.
Pour ce faire, Pékin mobilise un large éventail d’acteurs : le département de la Propagande du Parti communiste contrôle l’ensemble des médias d’État et une multitude de publications « visages humains » (magazines culturels, réseaux sociaux influencés, etc.) (LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE CHINOISES); le département du Front uni travaille à coopter les communautés chinoises d’outre-mer, les élites étrangères amicales et même des partis politiques étrangers (LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE CHINOISES); des entreprises chinoises, parfois sous la houlette de l’État, investissent dans des médias étrangers ou dans les infrastructures de télécommunication (ex : le fournisseur StarTimes diffuse des bouquets TV chinois en Afrique à prix modique, gagnant des millions d’abonnés et diffusant au passage CGTN, la télévision centrale chinoise, dans les foyers africains).
La désinformation “made in China” prend diverses formes. D’une part, la Chine diffuse massivement des contenus pro-Pékin via des médias officiels en de multiples langues (CCTV/CGTN, Xinhua, China Daily…) en s’efforçant d’apparaître comme une source respectable. D’autre part, elle recourt de plus en plus à des techniques clandestines rappelant celles de la Russie. Comme l’observe un spécialiste, on assiste à une « russianisation » des opérations d’influence chinoises, Pékin étant désormais prêt à infiltrer et contraindre au lieu de seulement séduire (LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE CHINOISES) (LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE CHINOISES). Par exemple, de vastes réseaux de faux comptes sur Twitter, Facebook, YouTube ont été découverts, propageant des discours alignés sur Pékin : des enquêtes occidentales ont révélé des campagnes numériques chinoises cherchant à discréditer les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, à minimiser les persécutions des Ouïghours, ou encore à relayer des théories complotistes accusant les États-Unis d’être à l’origine de la COVID-19. Durant la pandémie, certains diplomates chinois eux-mêmes (les fameux “Wolf Warriors”) ont tweeté que le virus aurait pu être introduit en Chine par l’armée américaine – une affirmation sans preuve, qui relève de la désinformation d’État visant à détourner les critiques sur la gestion initiale de l’épidémie.
La Chine mise également sur une approche subtile : recruter des voix locales ou étrangères influentes pour qu’elles portent son message. D’après un rapport de l’IRSEM, Pékin engage des influenceurs étrangers populaires afin de diffuser les récits du PCC de manière plus crédible pour les audiences cibles (Chine : désinformation, manipulations et agents d’influence sur les réseaux sociaux). Ces influenceurs – qui peuvent être des youtubeurs voyage, des personnalités politiques ou des experts présents dans les médias – présentent la Chine de façon positive (insistant sur ses succès économiques, sa contribution au développement en Afrique, etc.) tout en dénigrant ses “ennemis” occidentaux, notamment en soulignant les erreurs ou l’hypocrisie de Washington (Chine : désinformation, manipulations et agents d’influence sur les réseaux sociaux). L’avantage de cette approche est de faire passer la propagande chinoise non pas comme un message venu de Pékin, mais comme l’opinion spontanée d’une tierce partie digne de confiance, rendant le public moins méfiant. Par exemple, en Afrique francophone, de jeunes vloggeurs francophones employés par CGTN diffusent sur YouTube des reportages qui encensent la coopération sino-africaine et relativisent les critiques (dette, ingérence) – leur discours paraissant plus digeste qu’un communiqué officiel chinois.
Enfin, Pékin a compris l’importance de façonner le débat au sein des institutions internationales. Le gouvernement chinois use de son poids à l’ONU et dans les forums multilatéraux pour promouvoir sa vision d’Internet (souveraineté étatique sur le cyberespace, non-ingérence dans les “affaires intérieures” informationnelles) et pour faire adopter des termes favorables à ses positions dans les documents officiels. Tout cela concourt à l’arsenal global de désinformation chinoise : une combinaison de propagande officielle, de manipulation officieuse via le numérique, et de pressions politiques.
Notons pour être complets que d’autres États utilisent également la désinformation comme levier géopolitique. Des puissances régionales telles que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou le Qatar ont financé des médias ou des armées de trolls pour influencer l’opinion au-delà de leurs frontières (souvent pour améliorer leur image ou nuire à des rivaux régionaux). L’Iran a mené des campagnes en ligne ciblant ses voisins ou l’Occident pour propager ses narratifs (par exemple via PressTV en Afrique). Même de petites nations ont parfois tenté des coups informationnels. Loin de tout manichéisme, il faut retenir que la guerre de l’information est un jeu ouvert à quiconque en a les moyens techniques et financiers, et que toutes les grandes puissances y ont recours d’une manière ou d’une autre. La différence réside dans l’ampleur et le degré de déstabilisation visé.
Face à ce constat, les États qui en subissent les frais – souvent des pays plus vulnérables politiquement ou militairement – doivent analyser froidement ces menaces pour y opposer des ripostes adéquates. C’est ce que nous allons voir dans le cas de l’Alliance des États du Sahel, puis en dégageant des pistes d’action générales pour les nations africaines.
Étude de cas : l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) et la guerre de l’information
Contexte : des États fragilisés et saturés d’influences externes
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont formé en 2023 l’Alliance des États du Sahel (AES), offrent un exemple concret et actuel des dynamiques informationnelles complexes auxquelles font face certains pays africains. Ces trois États sahéliens ont en commun d’avoir vécu récemment des coups d’État militaires (2020-2022 pour le Mali, 2022 pour le Burkina, 2023 pour le Niger) à la suite d’une aggravation des conflits armés internes et d’un rejet grandissant de la présence militaire française jugée inefficace contre le terrorisme. Les changements de régime ont été accompagnés de profonds bouleversements géopolitiques : les nouvelles autorités ont pris leurs distances avec la France (allant jusqu’à l’expulsion de troupes françaises et la dénonciation de traités de coopération), tout en se tournant davantage vers d’autres partenaires, notamment la Russie (via la société paramilitaire privée Wagner et des accords sécuritaires), mais aussi la Chine, la Turquie ou d’autres. Cette réorientation s’est doublée d’une intense bataille de narratifs tant sur le plan interne qu’international, où chaque camp accuse l’autre de désinformation.
Du point de vue des gouvernements de transition au pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey, l’Alliance AES représente un élan de souveraineté collective africaine, qui dérange les anciennes puissances impérialistes. Selon eux, ces puissances (entendre la France en premier lieu, mais aussi les États-Unis ou d’autres alliés occidentaux) auraient lancé une “guerre communicationnelle” pour diviser l’alliance et dresser l’opinion contre les juntes. Un article du quotidien nigérien Le Sahel n’hésite pas à affirmer que depuis sa création le 16 septembre 2023, l’AES est « confrontée à une autre forme de guerre imposée par les puissances impérialistes et leurs valets locaux », ces derniers voyant dans cette alliance la fin de leur complot pour maintenir leur domination (Guerre communicationnelle : Innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes – Le Sahel). Le ton est donné : aux yeux des dirigeants de l’AES et de la presse qui leur est favorable, il existe un narratif mensonger piloté de l’étranger pour nuire aux trois pays, et il faut y répondre de manière tout aussi résolue.
Concrètement, les autorités malienne, burkinabè et nigérienne accusent leurs adversaires (extérieurs ou internes) de diffuser sur les réseaux sociaux des informations infondées visant à semer la peur, le doute ou la discorde entre les populations de l’alliance (Guerre communicationnelle : Innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes – Le Sahel). Des rumeurs allant de la fausse division interne au sein de la junte jusqu’à de prétendues exactions de l’armée contre des civils sont imputées à une propagande néocoloniale diffusée via Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. De plus, la présence de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique dans la région ajoute une couche de complexité : ces groupes et leurs partisans mènent eux aussi une guerre de l’information, propageant des discours de haine et de défiance envers l’État, parfois en collusion d’intérêts avec des puissances étrangères selon les autorités de l’AES. « L’espace de manœuvre de prédilection des terroristes, des puissances impérialistes et de leurs valets locaux est incontestablement la plateforme des réseaux sociaux par lesquelles ils essaient d’asphyxier la marche souveraine de ces trois États », écrit Le Sahel, qui parle d’une tentative de “déstabiliser la construction de la confédération” en diffusant vidéos et images choquantes pour éroder la confiance du peuple (Guerre communicationnelle : Innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes – Le Sahel). Ce discours reflète la perception, réelle ou exagérée, d’un siège informationnel autour des nouvelles autorités sahéliennes.
Du côté occidental, la lecture est bien différente. Les puissances comme la France y voient au contraire des régimes militaires cherchant à contrôler l’information pour masquer leurs propres abus et échecs. Elles pointent le rôle délétère de la Russie dans la région. En effet, de nombreuses enquêtes indépendantes convergent pour montrer qu’avant et après les coups d’État au Mali, au Burkina et au Niger, des campagnes pro-russes et anti-françaises ont inondé l’espace médiatique local, attisant l’opinion contre les présences occidentales. D’après le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, la Russie a “inondé le Sahel de désinformation” depuis 2018, menant 19 campagnes distinctes visant spécifiquement le Mali, le Burkina Faso et le Niger (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). Ces opérations informationnelles menées par des réseaux liés à Wagner et au Kremlin ont contribué à amorcer et promouvoir les putschs militaires dans ces trois pays (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). Le modus operandi consistait à utiliser les frustrations populaires (insécurité persistante, ressentiment post-colonial) pour légitimer les coups de force : les médias pro-russes et influenceurs locaux payés par ces réseaux ont acclamé chaque coup d’État comme une libération nationale, encouragé la répression des manifestations pro-démocratiques (qualifiées de mouvements manipulés par l’étranger) et présenté systématiquement ces événements sous un jour anti-français salvateur (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique).
Prenons le cas du Mali : depuis 2020, une pléthore de pages Facebook, de comptes Twitter anonymes et de vidéos YouTube ont martelé le narratif d’une France cynique voire complice des terroristes, et d’une Russie amie prête à sauver le Mali. En 2021, l’arrivée de mercenaires de Wagner au Mali a été précédée et accompagnée d’une campagne sur les réseaux sociaux vantant leurs supposés exploits et insinuant la trahison française. Au Burkina Faso, dans les mois qui ont précédé le coup d’État de janvier 2022, les analyses du Digital Forensic Research Lab montrent une montée en flèche du contenu pro-russe sur Facebook : en septembre 2021, les pages administrées depuis le Burkina ont augmenté par 19 le nombre de mentions du Groupe Wagner, colportant l’idée que ces mercenaires étaient déjà présents ou imminents pour aider la région (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup) (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup). Ces pages – non officiellement coordonnées entre elles – ont amplifié de fausses allégations selon lesquelles des soldats russes opéraient déjà en Afrique de l’Ouest, tout en martelant des récits antifrançais et prorusses sur la toile (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup). Lorsque le putsch est survenu, il n’est pas anodin que des manifestants burkinabè soient descendus dans la rue avec des drapeaux russes en acclamant les militaires – beaucoup témoignèrent s’être inspirés de l’intervention russe en Centrafrique et au Mali voisins (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup). Cela montre comment la préparation du terrain narratif a pu faciliter l’acceptation populaire du renversement du gouvernement civil, vu comme un pas vers un changement d’alliances géopolitiques.
Au Niger, les mois de juillet-août 2023 ont vu se dérouler la même séquence : aussitôt le coup d’État contre le président élu, une campagne médiatique bien rodée a présenté la junte comme les héros de la souveraineté et la France comme l’ennemi conspirant à la restauration de l’ancien régime. Les comptes liés à Wagner ont massivement encouragé la nouvelle donne, appelant même à la violence contre les partisans de l’ordre constitutionnel et à rejeter toute intervention de la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) en qualifiant cette dernière de marionnette de l’Occident (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique). En face, la France a tenté de défendre sa position via ses diplomates et médias, mais le climat populaire lui était très hostile, fruit de mois de matraquage anti-français sur Facebook, WhatsApp et dans les manifestations.
Ainsi, l’Alliance des États du Sahel se trouve au carrefour de plusieurs fronts de désinformation : les propagandes pro-AES (émanant des gouvernements maliens, burkinabè, nigériens et de leurs soutiens) qui dénoncent un complot occidental et justifient leurs politiques ; les propagandes pro-russes qui, par opportunisme, soutiennent l’AES tout en promouvant l’influence de Moscou et en diabolisant l’Occident ; et les contre-discours occidentaux qui tentent de mettre en garde contre une dérive autoritaire et l’instrumentalisation russe. Pour ne rien arranger, les citoyens de ces pays sont souvent pris dans un foisonnement non régulé d’informations contradictoires, sans toujours avoir les outils pour trier le vrai du faux. Le faible taux d’accès internet en zone rurale, compensé par une forte pénétration de WhatsApp, rend les rumeurs viralement partagées dans les groupes de discussion particulièrement difficiles à contrer (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international) (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international). La structure sociétale (forte influence des leaders locaux, religieux, etc.) fait que ce qui se dit à la mosquée ou au marché peut amplifier encore des messages biaisés (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international).
Réaction de l’AES : vers une souveraineté informationnelle collective
Conscients du péril que représente cette guerre de l’information multiforme, les États du Mali, du Burkina Faso et du Niger – au-delà de leur coopération militaire et diplomatique – ont entrepris de coordonner leur riposte médiatique au sein de l’AES. En août 2024, un atelier stratégique de communication s’est tenu à Bamako, réunissant des experts en communication des trois pays pour élaborer une stratégie commune (Lutte contre la désinformation au Sahel : L'AES envisage la création d’une web TV | Africa Cybersecurity Magazine) (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger). L’objectif affiché : « doter l’AES d’une communication capable de rassurer les populations locales tout en contrant les campagnes de désinformation qui cherchent à affaiblir l’union de ces trois États » (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger). Cet atelier, soutenu au plus haut niveau (présidé par le ministre malien de la Communication en présence de ses homologues), a acté plusieurs initiatives majeures, notamment la création d’une plateforme numérique conjointe avec une Web TV de l’Alliance. Une telle plateforme vise à fournir des informations fiables et instantanées aux citoyens des trois pays, en contournant les médias internationaux jugés biaisés et en occupant le terrain numérique pour éviter que les rumeurs hostiles ne dominent (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger). La Web TV de l’AES, dont le lancement était prévu mi-septembre 2024, s’inscrit dans cette volonté de reprendre la main sur le récit national et régional (Lutte contre la désinformation au Sahel : L'AES envisage la création d’une web TV | Africa Cybersecurity Magazine).
Ce faisant, l’AES entend renforcer sa crédibilité sur la scène internationale et restaurer la confiance du public local dans les médias nationaux (Lutte contre la désinformation au Sahel : L'AES envisage la création d’une web TV | Africa Cybersecurity Magazine). Il s’agit en quelque sorte de bâtir une souveraineté informationnelle partagée : plutôt que de combattre isolément les narratifs hostiles, le Mali, le Burkina et le Niger mutualisent leurs moyens de communication pour parler d’une voix forte. Cette stratégie est perçue comme un bouclier indispensable accompagnant l’action militaire et diplomatique conjointe de l’Alliance (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger) (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger). Elle touche à plusieurs axes : l’amélioration de la communication institutionnelle (communiqués harmonisés, messages communs), le développement d’une diplomatie publique offensive pour sensibiliser l’opinion internationale à “la justesse de [leur] cause” (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger), et bien sûr le renforcement des capacités numériques (création de comptes officiels certifiés sur les réseaux sociaux, présence accrue pour occuper le terrain face aux faux comptes). L’idée est que l’AES ne doit plus subir la narration des événements, mais la produire et la diriger elle-même.
Un commentaire d’observateur publié suite à cet atelier souligne la nécessité d’impliquer largement la société civile dans cette bataille de l’information : « Les citoyens de l’AES doivent prendre en main eux-mêmes la stratégie de défense contre la guerre informationnelle que nous livre la France », écrit un internaute, appelant à la création de forums et plateformes de discussions en ligne pour permettre aux intellectuels et aux patriotes africains de démonter la « propagande néocoloniale française » (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger) (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger). Ce point de vue reflète un courant panafricaniste qui considère qu’au-delà de l’appareil d’État, c’est la mobilisation de la population (notamment des jeunes très actifs sur Facebook ou TikTok) qui fera la différence pour répliquer aux “fake news” étrangères et affirmer une narrative autonome. D’autres commentateurs restent sceptiques, qualifiant ces efforts de « propagande de plus » ou d’« inepties » (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger), ce qui traduit le défi : comment instaurer une stratégie d’information souveraine sans tomber dans la propagande interne stérile ?
Il est trop tôt pour juger de l’efficacité de la Web TV AES et des mesures prises, mais cet exemple offre déjà des enseignements. D’un côté, on constate l’importance pour un État (ou un groupement d’États) de se doter de canaux de communication autonomes lorsqu’il se sent visé par des campagnes d’influence étrangères. Renforcer les médias nationaux ou régionaux – en particulier dans l’espace numérique où se concentre aujourd’hui la bataille – apparaît comme une réponse naturelle pour occuper l’espace narratif. De l’autre, le risque est de tomber dans un discours fermé où toute critique est attribuée à un complot étranger, ce qui peut nuire à la crédibilité à long terme. L’équilibre est donc subtil entre contre-propagande nécessaire et pluralisme de l’information.
Le cas de l’AES illustre bien les dilemmes auxquels font face les États africains : comment contrer efficacement les ingérences informationnelles de grandes puissances (jadis coloniales ou nouvelles) tout en préservant l’adhésion de sa population et en évitant l’isolement international ? C’est un numéro d’équilibriste qui nécessite des approches multidimensionnelles. Forts de ces analyses, nous allons formuler dans la section suivante des recommandations concrètes et pragmatiques que pourraient envisager les États africains – qu’ils fassent partie ou non de l’AES – pour renforcer leur souveraineté informationnelle et se protéger dans ce nouveau “grand jeu” de la désinformation mondiale.
Renforcer la souveraineté informationnelle : recommandations pour les États africains
Les États africains ciblés par des campagnes de désinformation étrangères doivent élaborer une riposte globale, mêlant leviers juridiques, diplomatiques, numériques, éducatifs et médiatiques. L’approche doit être à la fois offensive (déjouer et contrer la propagande hostile) et défensive (renforcer la résilience interne de la société face aux infox). Voici, dans un esprit pragmatique, cinq axes de recommandations :
1. Mesures juridiques et institutionnelles
Un cadre juridique adapté peut donner aux États des outils pour se protéger de la désinformation sans porter atteinte indûment à la liberté d’expression. Quelques pistes :
Adopter des lois ciblant la désinformation malveillante : Il s’agit de pénaliser la diffusion délibérée de fausses nouvelles portant atteinte à la sûreté de l’État ou à la cohésion sociale, en particulier lorsqu’elles sont commanditées par une puissance étrangère. Plusieurs pays africains ont déjà adopté des lois “anti-fake news”, notamment suite à la pandémie de COVID-19 (Senegal: Les lois visant à lutter contre les 'fausses nouvelles ...). Ces lois doivent être élaborées avec soin pour viser les campagnes coordonnées et la désinformation de guerre, et non pour museler les opposants politiques ou les journalistes. Par exemple, on peut incriminer la fabrication et la diffusion de faux documents (lettres, rapports) émanant prétendument d’autorités nationales, lorsque cela vise à tromper le public – un phénomène constaté dans les ingérences étrangères (cf. les fausses lettres utilisées par le KGB ou d’autres (La désinformation aux Etats Unis | INA)). Des peines dissuasives (amendes, prison) peuvent être prévues, tout en encadrant strictement la procédure (recours possibles pour éviter les abus).
Renforcer les capacités des organes de régulation des médias : Les instances telles que les Conseils nationaux de la communication ou les Autorités de régulation de l’audiovisuel doivent être outillées pour détecter et sanctionner les médias (y compris en ligne) qui relaient sciemment de la désinformation étrangère. Par exemple, si une chaîne de télévision ou un site web local sert de relai à une propagande d’État étranger (via du contenu sponsorisé ou des « copier-coller » de fausses dépêches), le régulateur doit pouvoir exiger un droit de réponse, voire suspendre la diffusion en cas de récidive avérée. Cette surveillance doit s’appliquer également aux médias internationaux émettant dans le pays : exiger la transparence sur leur financement et, en cas de biais manifeste ou de fausses nouvelles répétées, utiliser les leviers diplomatiques (convocation des ambassadeurs, etc.) ou juridiques (suspension temporaire d’accréditation, par exemple) pour faire cesser le trouble. Naturellement, ces mesures doivent respecter les engagements internationaux en matière de liberté de la presse – la suspension ne peut être qu’un dernier recours lorsque la désinformation est patente et dommageable.
Encadrer les plateformes numériques : Juridiquement, les États africains peuvent adopter des dispositions obligeant les grandes plateformes (Facebook, Twitter/X, YouTube, TikTok, WhatsApp) à coopérer dans la lutte contre les campagnes de désinformation orchestrées. Par exemple, en exigeant la suppression rapide des faux comptes identifiés comme appartenant à des opérations d’influence étrangères (comme celles que Facebook a démantelées en 2020 ()). Des accords peuvent être passés avec ces entreprises pour améliorer la modération des contenus dans les langues locales et pour donner accès aux données nécessaires à l’attribution des campagnes (tout en respectant la vie privée des utilisateurs). Au besoin, une législation type “loi sur les services numériques” (inspirée du Digital Services Act européen) pourrait être envisagée localement pour imposer des obligations en matière de transparence des algorithmes et de lutte contre la manipulation coordonnée.
Institutionnaliser la réponse : Créer en sein de l’appareil d’État une cellule spécialisée de veille et de contre-désinformation. Cette unité, rattachée par exemple au ministère de la Communication ou à la Présidence, serait chargée d’identifier les fake news circulant sur le pays, d’en remonter la source possible (notamment si cela provient d’États étrangers ou de leurs affiliés), et de coordonner la riposte (démentis officiels, plaintes judiciaires, exposé public des ingérences, etc.). Elle pourrait collaborer avec les services de renseignement pour suivre les ingérences informationnelles (car la désinformation d’État va souvent de pair avec l’espionnage et la subversion). L’existence d’une telle cellule permet de montrer que l’État prend au sérieux la menace tout en traitant la question de manière professionnelle et factuelle, plutôt que de manière purement politique ou émotive.
NB : Toutes ces mesures juridiques doivent s’accompagner de garde-fous pour éviter qu’elles ne deviennent un prétexte autoritaire. Un moyen d’y veiller est d’associer à leur élaboration et à leur mise en œuvre des organes indépendants (haute autorité, commission multipartite) et la société civile (associations de presse, experts), de façon à trouver le juste équilibre entre lutte contre la désinformation et respect des libertés.
2. Riposte diplomatique et coopération internationale
La lutte contre la désinformation d’État ne peut être qu’en partie interne ; elle a aussi une dimension externe, relevant de la diplomatie et de la coopération entre pays africains et partenaires. Quelques recommandations en ce sens :
Nommer et dénoncer les ingérences de manière officielle : Trop souvent, les campagnes de désinformation restent dans le domaine du secret ou de l’informel. Lorsque des preuves solides existent qu’un État étranger mène une campagne malveillante (par exemple, identification d’agents impliqués, de financements, ou concordance d’une narrative avec des intérêts étatiques), le gouvernement ciblé devrait envisager de publier un rapport ou un livre blanc exposant ces faits. Cela permet de prendre à témoin la communauté internationale et ses propres citoyens. Par exemple, si l’on reprend le cas du Niger où des documents de la DGSE française ont été brandis (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info) : la France comme le Niger pourraient, au lieu de se contenter d’échanges médiatiques, soumettre le cas à des instances internationales (ONU, UA) avec les documents à l’appui pour qu’une enquête impartiale juge de leur authenticité et du contexte. De même, des États baltes comme l’Estonie ont régulièrement publié des rapports détaillant les opérations d’influence russes dont ils sont la cible – une transparence qui les a aidés à rallier le soutien de l’UE. Les pays africains pourraient s’en inspirer.
Utiliser les mécanismes juridiques internationaux : La désinformation transfrontalière n’est pas encore pleinement encadrée par le droit international, mais des concepts comme la non-ingérence et la souveraineté peuvent être invoqués. Un État africain victime d’une campagne de déstabilisation informationnelle peut déposer une plainte officielle auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU (surtout si cette campagne s’accompagne d’autres ingérences) ou saisir les organes régionaux (Union Africaine, CEDEAO, SADC…). L’objectif est double : dissuader l’État indélicat en lui donnant une visibilité négative, et inscrire la question de la désinformation à l’agenda diplomatique. Par exemple, l’UA pourrait être encouragée à adopter une résolution condamnant les campagnes de désinformation entre États africains, ce qui créerait une norme politique. À terme, on pourrait militer pour une convention internationale (ou africaine) sur la lutte contre la manipulation de l’information, définissant des principes et engagements entre États – même si leur respect effectif resterait soumis à la volonté politique.
Coopération régionale sud-sud : Les pays africains gagneraient à échanger leurs expériences et bonnes pratiques face à la désinformation. Par exemple, les pays d’Europe de l’Est ont mis en place le Centre d’excellence pour la communication stratégique de l’OTAN (StratCom) à Riga pour mutualiser leurs analyses. De même, on pourrait imaginer un Centre africain de lutte contre la désinformation, sous l’égide de l’Union Africaine ou d’une coalition volontaire de pays, qui servirait de plateforme de partage d’informations sur les ingérences en cours, de formation d’experts et de développement d’outils adaptés aux contextes africains (par exemple, un système d’alerte rapide si de fausses nouvelles commencent à circuler sur WhatsApp dans plusieurs pays simultanément, ou si un même groupe de faux comptes s’active dans différentes langues). L’efficacité de la riposte serait démultipliée par cette approche collective, car souvent les campagnes malveillantes ne s’arrêtent pas aux frontières (on l’a vu avec la Russie qui cible 22+ pays d’Afrique avec des schémas similaires (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique)).
Dialoguer avec les grandes puissances dans des cadres établis : Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut aussi utiliser la diplomatie classique pour traiter du problème directement avec les États suspectés d’ingérence. Des canaux bilatéraux ou multilatéraux peuvent servir à exprimer des mises en garde. Par exemple, si un pays africain dispose d’indices sur une opération de désinformation menée par un pays X, il peut demander des explications via son ambassade à X, ou aborder la question lors de consultations politiques régulières. Le simple fait de montrer à l’autre partie que l’on n’est pas dupes et que l’on surveille ses actions peut parfois suffire à la modérer – du moins si l’ingérence en question n’est pas au cœur de sa stratégie. Évidemment, cela est plus facile à dire qu’à faire quand il s’agit de grandes puissances pour qui la manipulation de l’information est un instrument assumé (la Russie, par exemple, nie systématiquement toute implication et traite ce sujet par le déni ou le contre-accusation). Néanmoins, avec d’autres partenaires, un dialogue peut exister : on peut rappeler aux pays occidentaux qu’eux-mêmes s’estiment menacés par des fake news étrangères et qu’ils devraient donc s’abstenir d’en employer ailleurs. De la même façon, engager la Chine sur le terrain de l’éthique de l’information (via le Forum sur la Coopération sino-africaine par exemple) peut être un moyen de la responsabiliser un tant soit peu.
Soutenir la création de normes internationales : Comme mentionné, la communauté internationale n’a pas encore de traité spécifique sur la cyber-désinformation, mais des processus existent (ONU – groupe d’experts sur la cybersécurité, appel de Paris pour la confiance dans le cyberespace, etc.). Les États africains doivent activement prendre part à ces discussions et y apporter leur perspective unique. Par exemple, plaider pour une distinction claire entre propagande légale et désinformation illégale, ou pour un mécanisme d’attribution neutre des campagnes (une sorte d’“observatoire” onusien de la désinformation mondiale). Être présent dans ces débats permettra d’éviter que seules les grandes puissances définissent les règles du jeu.
En somme, le volet diplomatique consiste à porter le combat sur la scène internationale, afin de délégitimer la désinformation en la faisant reconnaître pour ce qu’elle est : une atteinte à la souveraineté, une menace pour la paix (car elle peut attiser des conflits), et un procédé lâche contraire à la confiance entre nations. Une condamnation explicite par des organisations régionales des fake news en tant qu’outil de déstabilisation serait un soutien précieux pour les pays ciblés.
3. Outils numériques et cybersécurité
Dans le contexte actuel, la bataille se joue en grande partie en ligne. Il est donc impératif de développer des capacités numériques pour détecter, suivre et contrer la désinformation. Voici quelques recommandations techniques et organisationnelles :
Systèmes de veille et d’alerte automatisés : Investir dans des outils numériques (potentiellement en partenariat avec des entreprises tech ou des universités) capables de faire de la veille sur les réseaux sociaux en temps réel. Par exemple, des programmes de traitement automatique du langage peuvent repérer quand un mot-clé associé à une rumeur commence à exploser en fréquence sur Facebook ou Twitter, ou quand de nouveaux comptes suspects prolifèrent dans un espace linguistique. Ces systèmes d’alerte précoce aideraient les autorités à repérer les signes avant-coureurs d’une campagne de désinformation naissante pour réagir plus vite. On pourrait imaginer une plateforme nationale de suivi de la désinformation, alimentée par de l’IA, qui classe les infox par dangerosité et suggère des ripostes (publication d’un démenti, conférence de presse, etc.).
Renforcement de la cybersécurité des institutions : Souvent, la désinformation s’appuie sur des fuites ou des piratages (par exemple, des courriels volés à un ministre puis publiés hors-contexte, ou des faux documents insérés dans de vrais systèmes). Les États africains doivent améliorer la sécurité de leurs systèmes d’information pour ne pas fournir de munitions faciles aux adversaires. Cela passe par la formation aux bonnes pratiques (anti-phishing, gestion des mots de passe), la mise à jour des logiciels officiels, l’audit régulier des sites web gouvernementaux (pour éviter le défacement ou l’injection de fausses nouvelles). Une rumeur très dangereuse est que “tel gouvernement cache telle catastrophe” – si le site du ministère de la Santé est protégé de toute intrusion, il ne pourra pas être compromis pour y faire figurer de fausses données, par exemple. La capacité à prouver l’intégrité des sources officielles est cruciale pour ne pas laisser le champ libre aux infox.
Contre-discours en ligne et occupation du terrain : Au-delà de la défensive, les États doivent être présents en ligne pour diffuser leurs messages. Cela signifie soutenir la création de comptes officiels et vérifiés (avec badge de certification) pour les institutions et les principaux responsables, afin que les citoyens sachent où trouver l’information fiable de première main. Lorsqu’une fausse nouvelle circule, il est impératif qu’un compte officiel puisse poster rapidement une mise au point qui sera reprise. Par exemple, si une rumeur indique un incident sécuritaire inexistant, la police ou l’armée via Twitter doit immédiatement publier un démenti clair. En occupant le terrain numérique, on réduit l’audience laissée aux faux comptes. Les gouvernements africains pourraient aussi envisager de former des porte-parole “digitaux” capables d’intervenir dans les débats en ligne (sur les forums, les groupes Facebook) pour apporter contradictoire et factualité, sans verser dans l’insulte ou la menace. Il s’agit presque d’une diplomatie publique en ligne, à mi-chemin entre la communication institutionnelle et l’échange avec la communauté.
Exploitation de l’intelligence artificielle : La technologie de l’IA peut aider non seulement à détecter la désinformation, mais aussi à la combattre par des moyens innovants. Par exemple, développer des chatbots ou des assistants virtuels qui circuleraient sur des messageries comme WhatsApp pour débusquer les infox et fournir aux utilisateurs qui le souhaitent la vérification correspondante. On peut imaginer s’inscrire à un service qui nous alerte : “Attention, le message que vous venez de recevoir contient des informations démenties par telle source”. Certaines initiatives privées existent déjà (WhatsApp avait collaboré avec Africa Check pour un service pilote de fact-checking automatisé pendant les élections). Les États pourraient soutenir financièrement et logistiquement ces innovations et encourager les jeunes développeurs locaux à proposer des solutions adaptées aux langues et cultures locales.
Souveraineté numérique et hébergement local : À plus long terme, un enjeu de souveraineté informationnelle est aussi d’ordre technique : ne pas dépendre entièrement d’infrastructures numériques contrôlées par l’étranger. Envisager de renforcer les capacités locales d’hébergement de données (data centers nationaux ou africains), encourager des réseaux sociaux locaux ou régionaux pourrait apporter une résilience. Par exemple, s’il existait une plateforme africaine de partage vidéo ou un réseau social panafricain modéré selon des standards transparents, cela offrirait une alternative face aux algorithmes de YouTube ou Facebook souvent opaques et manipulables par des acteurs étrangers. Bien sûr, créer de toutes pièces de tels géants n’est pas simple, mais des niches sont possibles (pourquoi pas une messagerie panafricaine sécurisée pour réduire l’emprise de WhatsApp dans les communications sensibles, etc.). L’Union africaine discute déjà de “souveraineté numérique” sur le plan économique ; y adosser la composante informationnelle serait judicieux.
Simulations et exercices : Tout comme on fait des exercices militaires, on pourrait organiser des exercices de simulation de crise informationnelle. Par exemple, simuler une campagne massive de désinformation durant une élection ou une crise sanitaire, et tester comment les services de l’État réagissent, comment les médias relaient la vérité, etc. Cela permettrait d’identifier les failles (techniques, coordination, message) et d’entraîner les équipes à garder la tête froide en situation de “bombe informationnelle”. Des partenariats avec des organismes internationaux qui ont l’expertise (l’UNESCO propose des modules, ou des ONG comme Internews) peuvent aider à concevoir ces simulations de manière réaliste.
En résumé, l’axe numérique consiste à allier la technologie et l’humain pour regagner la maîtrise de l’espace en ligne : technologie pour la détection et la protection, humain pour la communication crédible et la présence vigilante. C’est un domaine où les jeunesses africaines talentueuses peuvent être mises à contribution, en mobilisant développeurs, community managers, experts en cybersécurité autour de la défense de l’intérêt national.
4. Éducation médiatique et résilience sociétale
Aucune stratégie anti-désinformation ne sera pleinement efficace sans travailler en profondeur sur le public récepteur. Renforcer la souveraineté informationnelle, c’est aussi armer chaque citoyen d’un esprit critique et des moyens de ne pas se laisser manipuler. Dans de nombreux pays africains, où l’éducation aux médias est naissante et où la culture de l’oralité reste forte, il y a un gros travail de fond à mener. Voici quelques recommandations clés :
Introduire l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans les cursus scolaires et universitaires : Dès le secondaire, les élèves devraient apprendre à analyser une information, distinguer source fiable et rumeur, comprendre comment les images peuvent être truquées, etc. Cela peut se faire via des cours dédiés ou intégrer dans des cours d’histoire/géographie, éducation civique. L’UNESCO a développé des guides d’EMI adaptables que les ministères de l’Éducation peuvent contextualiser. Par exemple, faire travailler les élèves sur un cas réel de fausse nouvelle qui a circulé dans leur pays, et leur faire reproduire le travail de vérification. À l’université, des modules pour toutes filières sur la pensée critique face aux médias numériques seraient bénéfiques – car les futurs fonctionnaires, ingénieurs, médecins seront aussi confrontés à la désinformation (on a vu lors du COVID-19 que même des responsables ont pu relayer des inepties faute de connaissances scientifiques (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international)). Former la jeunesse, c’est bâtir une génération plus résistante aux manipulations, à moyen terme.
Sensibiliser via des campagnes grand public : Parallèlement à l’école, il faut toucher la population générale, y compris les adultes peu scolarisés. Des campagnes de communication sur le « comment vérifier une info avant de la croire et la partager » peuvent être diffusées à la radio, à la télévision nationale, sur les réseaux sociaux. Par exemple, une mini-série télé ou des clips mettant en scène un citoyen piégé par une fausse rumeur puis apprenant comment l’éviter la prochaine fois. Ou des interventions dans les lieux de culte et associations pour discuter du danger des fake news. L’objectif est de créer un réflexe de méfiance saine : que chacun, avant de s’indigner sur un message WhatsApp, se demande “qui en est l’auteur ? pourquoi ça m’est transmis ? est-ce crédible ?”. Les gouvernements peuvent appuyer les ONG locales qui font ce travail (beaucoup d’associations de fact-checking en Afrique – Africa Check, Dubawa, CongoCheck, etc. – organisent déjà des ateliers grand public, il faut amplifier leur portée).
Encourager le fact-checking et les “décodeurs” locaux : Justement, soutenir les organisations indépendantes de vérification des faits est primordial. Cela peut passer par des fonds, de la formation, ou simplement la reconnaissance officielle de leur rôle (inclure leurs représentants dans des instances de réflexion, etc.). Plus il y aura d’entités crédibles pour démystifier les rumeurs, plus la population aura accès facilement au contrepoids. Par exemple, si une fausse information médicale se propage, il faudrait qu’immédiatement un site de fact-checking local (en langue locale de préférence) propose l’explication et que ce site soit connu du public. On peut imaginer chaque grand média national avec sa rubrique “Vrai ou Faux” traitant les sujets du moment. L’État pourrait offrir des avantages (accès facilité à l’information officielle, interviews) aux médias qui s’engagent dans ce journalisme de vérification, sans bien sûr contrôler leur contenu.
Travailler avec les leaders d’opinion traditionnels : En Afrique, les chefs coutumiers, religieux, artistes, influenceurs locaux ont une influence considérable sur l’opinion, parfois plus que les médias officiels. Il faut donc les intégrer dans la stratégie. Les former (sans condescendance) aux enjeux de la désinformation peut en faire des alliés puissants. Par exemple, convaincre un imam respecté de dénoncer en chaire les ravages des fausses nouvelles qui montent les communautés les unes contre les autres, ou qu’un chanteur populaire intègre dans ses chansons un message sur “ne crois pas tout ce qu’on te raconte sur Facebook”. Certains pays ont vu naître des spectacles de théâtre forum ou des bandes dessinées pédagogiques sur ce thème. Ce sont d’excellentes idées à multiplier. Le pouvoir des histoires et des formats familiers est crucial : les créateurs de fake news l’ont compris en utilisant vidéos virales et contenus simples (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international), il faut répondre sur ce terrain en rendant la vérité tout aussi attrayante et accessible.
Renforcer l’enseignement du journalisme et l’éthique : Les écoles de journalisme africaines devraient adapter leurs programmes pour former les futurs journalistes à détecter la désinformation et à ne pas y contribuer. Cela inclut la vérification numérique, le recoupement des sources sur les réseaux sociaux, mais aussi l’éthique de ne pas céder aux titres sensationnalistes non vérifiés. Des modules sur la guerre de l’information pourraient être intégrés, avec l’étude de cas historiques (comme ceux abordés plus haut sur la CIA, le KGB, etc., pour bien montrer que la manipulation existe et peut les affecter). Un journalisme d’investigation de qualité peut même révéler et contrer des campagnes en cours, ce qui serait la meilleure défense.
Cohésion sociale et diversité des voix : Sur un plan plus large, la résilience passe par une société unie où les clivages (ethniques, religieux, politiques) ne peuvent être trop facilement exploités par des narratifs extérieurs. Si les citoyens se sentent tous embarqués dans le même projet national, ils seront moins réceptifs aux messages d’incitation à la haine ou à la division venus de l’étranger. Dans cet esprit, promouvoir le dialogue interne, la réconciliation quand il y a eu conflits, et donner une place médiatique à toutes les composantes de la nation (pour éviter que l’une d’entre elles ne cherche son salut dans une alliance avec l’étranger) est une stratégie de long terme contre l’ingérence. En effet, de nombreux cas de désinformation efficace exploitent des fractures internes : par exemple, la Russie attise les sentiments antifrançais latents, ou telle puissance joue sur les tensions entre communautés locales. Plus ces fractures sont comblées ou gérées, plus la propagande extérieure perd de son efficacité.
En synthèse, l’éducation médiatique et la mobilisation sociale visent à créer un rempart psychologique dans chaque esprit contre la désinformation. Lorsque chaque individu devient son propre “garde-fou” critique, les campagnes hostiles ont beaucoup moins de prise. C’est un travail de longue haleine, certes, mais aux effets profonds et durables pour la souveraineté informationnelle.
5. Stratégies médiatiques et renforcement du paysage informationnel
Le dernier volet, et non des moindres, est celui des médias eux-mêmes. Pour contrer la désinformation d’États tiers, un pays africain doit disposer d’un écosystème médiatique souverain, robuste et pluraliste, afin que la vérité et la narration nationale puissent y prospérer sans être étouffées par des voix extérieures. Voici quelques recommandations focalisées sur les médias :
Soutenir le développement de médias locaux de qualité : Un vide médiatique local fait le lit de la propagande étrangère. Si les citoyens ne trouvent pas dans leur presse nationale les informations ou les analyses qu’ils recherchent, ils iront les chercher sur des médias internationaux (RFI, BBC, Russia Today, CGTN, Al-Jazeera, etc.), qui portent chacun l’agenda de leur pays d’origine. Il est donc stratégique d’investir dans le renforcement des capacités des médias nationaux et panafricains. Cela peut passer par des fonds publics (subventions, fonds de soutien) bien utilisés, par des incitations fiscales pour la presse, ou par l’encouragement du secteur privé à s’impliquer (publicité responsable). Le but est d’avoir des rédactions professionnelles, bien équipées, capables de faire du reportage de terrain et de produire du contenu attractif. Par exemple, au lieu que les documentaires sur l’histoire africaine soient monopolisés par des chaînes étrangères, financer des documentaires locaux diffusés à une heure de grande écoute qui renforcent la connaissance de sa propre histoire, pourrait réduire l’attrait des récits extérieurs. Un public bien informé par ses propres médias sera moins perméable aux narratifs importés.
Créer des plateformes médiatiques panafricaines : Sur des enjeux communs (comme l’AES l’a compris), s’unir pour diffuser le message peut amplifier la portée. Pourquoi ne pas imaginer une agence de presse panafricaine renforcée, qui fournirait des dépêches aux journaux de tous les pays, avec un regard africain sur les événements mondiaux ? Ou une chaîne d’information africaine multilingue de référence, qui rivaliserait avec CNN, BBC, France24 en offrant un angle différent ? Des tentatives comme Africa24 ou Afrique Média existent, mais gagneraient à être davantage soutenues et professionnalisées pour accroître leur audience et leur crédibilité. L’ère numérique permet aussi des collaborations transfrontalières : des médias de différents pays pourraient co-produire des enquêtes sur les ingérences étrangères, donnant une résonance continentale à ces sujets et montrant une solidarité. Ce faisant, les Africains pourraient raconter leurs propres histoires et exposer les manipulations dont ils sont l’objet, plutôt que d’attendre que cela vienne d’un reportage du New York Times ou de France 24.
Moderniser la communication gouvernementale : Les gouvernements doivent eux-mêmes adopter une approche médiatique moderne. Finies les communications descendantes et empesées qui n’atteignent pas le public ! Il faut innover : conférences de presse interactives retransmises en direct sur les réseaux, FAQ en ligne où les officiels répondent aux questions des citoyens, podcasts animés par des jeunes pour discuter des politiques publiques, etc. Plus la communication institutionnelle sera transparente, réactive et humaine, moins le public aura tendance à croire les rumeurs farfelues. Par exemple, lors d’une crise, au lieu d’un communiqué austère lu 24h après, organiser un Facebook Live où un ministre explique la situation en temps réel et répond aux inquiétudes peut couper l’herbe sous le pied aux intox qui prospèrent dans le silence. Cette capacité à communiquer efficacement renforce la confiance du peuple dans la version donnée par ses dirigeants, plutôt que dans les bruits de couloir alimentés de l’étranger.
Valoriser les langues locales et la proximité : La désinformation sait utiliser la proximité culturelle – un message audio en wolof ou en bambara circule mieux parmi les locuteurs concernés qu’un texte en anglais. Il faut donc que les médias nationaux et les communications officielles investissent dans le multilinguisme local. Radios communautaires, télévisions régionales, pages Facebook en langue vernaculaire : soutenir ces vecteurs permettra de toucher les populations souvent délaissées, et de les fidéliser à des sources d’information authentiques. Par exemple, si une fake news se répand sur WhatsApp en hausa, il serait pertinent qu’un démenti soit aussitôt diffusé sur les radios locales en hausa et via des influenceurs s’exprimant dans cette langue. Cela rejoint l’idée d’“occuper le terrain” jusque dans les réseaux sociaux locaux (groupes fermés, etc.) grâce à des relais de confiance issus de ces communautés.
Éthique et impartialité pour gagner la confiance : Enfin, un point crucial est la crédibilité. Un État ne gagnera pas la guerre de l’info en exigeant simplement qu’on le croie sur parole – il doit mériter la confiance. Cela implique de respecter autant que possible la vérité dans sa propre communication, d’admettre les erreurs quand elles arrivent, de ne pas chercher à cacher les faits dérangeants par principe. En d’autres termes, combattre la désinformation ne doit pas devenir faire de la contre-désinformation. Si les médias publics se transforment en organes de propagande aveugle, le public s’en détournera, ouvrant un boulevard aux influenceurs étrangers. Donc, encourager le journalisme d’investigation national même s’il dérange, tolérer la satire et la critique, c’est paradoxalement une force dans le temps : cela montre que le pays a une presse libre et digne de foi. Les grandes puissances, elles, jouent souvent sur l’ambiguïté de leurs médias (RT se dit indépendante mais suit le Kremlin, Voice of America se dit neutre mais est financée par Washington). Un petit pays peut choisir la voie de la transparence pour se distinguer : nos médias sont libres, donc ce qu’ils disent est digne de foi – et quand ils critiquent une ingérence, ce n’est pas une ligne imposée, c’est la réalité. Cette hauteur morale peut désarmer bien des tentatives de semer le doute.
En somme, le renforcement médiatique consiste à construire une sphère informationnelle nationale/régionale solide : des médias variés, proches des citoyens, intégrés dans le tissu social, capables d’informer vite et bien, et surtout bénéficiant de la confiance du public. C’est le meilleur rempart contre n’importe quelle désinformation venue d’ailleurs, car même si l’info toxique circule, elle sera noyée dans un flot de contre-discours crédibles portés par les médias locaux.
Conclusion
Face à la montée des campagnes de désinformation orchestrées par des États – qu’il s’agisse des manipulations numériques de la Russie en Afrique, des influences subtiles de la Chine, des opérations psychologiques héritées de la guerre froide menées par l’Occident, ou de l’activisme d’anciennes puissances coloniales –, les États africains se trouvent en première ligne d’une nouvelle lutte pour leur souveraineté. Cette lutte, moins visible qu’un conflit armé, se joue dans les esprits et dans l’espace médiatique. Pour la remporter, il ne suffit pas de dénoncer les “impérialistes” ou au contraire de censurer internet. La réponse doit être stratégique, mesurée et globale.
Nous avons exposé comment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, via l’Alliance des États du Sahel, tentent de relever ce défi en s’unissant pour contrer les narratifs hostiles tout en affirmant leur propre voix sur la scène mondiale. Leur expérience, riche d’enseignements, montre l’importance de reprendre l’initiative : ne plus subir l’information, mais la produire et la maîtriser. Toutefois, elle rappelle aussi les écueils à éviter : le repli sur une propagande purement défensive peut certes mobiliser à court terme, mais risque de polariser davantage et de faire perdre en crédibilité s’il n’est pas couplé à une ouverture et à une objectivité suffisantes.
La voie à suivre pour les États africains se situe donc dans un équilibre : être offensifs dans la défense de leur récit national (par des moyens juridiques, diplomatiques, techniques et médiatiques), tout en restant impartiaux et rigoureux dans le traitement de l’information. L’article a présenté des recommandations concrètes allant de l’ajustement légal (lois anti-désinformation bien conçues) à la mobilisation citoyenne (éducation aux médias, implication des leaders d’opinion), en passant par l’innovation numérique (veille algorithmique, réseaux sociaux investis) et le renforcement du journalisme local. Ces mesures forment un tout cohérent pour bâtir une souveraineté informationnelle – c’est-à-dire la capacité d’un État à préserver l’intégrité de son espace informationnel et à s’exprimer librement sans être étouffé par des narratifs étrangers.
En filigrane, c’est une vision panafricaine qui se dessine : celle d’un continent capable de se raconter lui-même au lieu d’être le réceptacle des propagandes des autres. Un continent où la diversité des voix n’est plus une faiblesse exploitée par tel ou tel empire, mais une force convergeant vers la vérité et l’intérêt commun. Utopique, diront certains – mais l’histoire enseigne que chaque avancée en matière de souveraineté, qu’elle soit politique, économique ou culturelle, a commencé par un sursaut de conscience et une stratégie collective. La lutte contre la désinformation n’échappe pas à la règle.
En définitive, qu’il s’agisse de contrer les fake news sur WhatsApp au village ou les narratifs biaisés dans les hautes sphères diplomatiques, la clé sera la même : connaissance, unité et vigilance. La connaissance des mécanismes de manipulation pour mieux s’en prémunir ; l’unité nationale et africaine pour ne pas laisser l’adversaire jouer sur les divisions ; la vigilance de chaque instant car la forme de la menace évolue sans cesse. Avec ces atouts en main, un État africain ciblé n’est pas condamné à l’impuissance : il peut, au contraire, transformer cette épreuve en catalyseur pour renforcer la confiance de son peuple envers lui et faire triompher, au bout du compte, sa vérité sur le mensonge imposé d’autrui
.
Sources :
Les Crises, « La CIA et son réseau mondial de propagande (1977) », archives d’après le New York Times, 1977 ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)) ( » La CIA et son réseau mondial de propagande (1977)).
INA (Sept sur sept, 1982), « La désinformation aux États-Unis », explication des méthodes de désinformation soviétiques et américaines pendant la guerre froide (La désinformation aux Etats Unis | INA) (La désinformation aux Etats Unis | INA).
Ecole de Guerre Économique, « Opération INFEKTION : le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA », 2021 (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique) (Opération INFEKTION : Le cas d’une campagne de désinformation réussie sur le SIDA | Ecole de Guerre Economique).
France24, « KGB en Afrique : modus operandi d’une URSS en quête d’influence », 20/07/2023 (Revue de presse du 20 juillet 2023 – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique) (Revue de presse du 20 juillet 2023 – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique).
Graphika/Stanford, « More Troll-Kombat: French and Russian Influence Operations in Africa », rapport du 15/12/2020 () ().
African Center for Strategic Studies, « Cartographie de la désinformation en Afrique », 01/04/2024 (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique) (Cartographie de la vague de désinformation en Afrique – Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique).
DFRLab (Atlantic Council), « Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso coup », 17/02/2022 (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup) (Local support for Russia increased on Facebook before Burkina Faso military coup).
Article Le Sahel (Niger), « Guerre communicationnelle : innover pour déconstruire le narratif mensonger… », 2024 (Guerre communicationnelle : Innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes – Le Sahel) (Guerre communicationnelle : Innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes – Le Sahel).
ActuNiger, « Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication commune… », 24/08/2024 (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger) (ActuNiger | Alliance des États du Sahel : vers une stratégie de communication et une plateforme numérique de diffusion avec Web TV pour renforcer la résilience et la souveraineté régionale - ActuNiger).
Africa Cybersecurity Mag, « Lutte contre la désinformation au Sahel : l’AES envisage la création d’une web TV », 28/08/2024 (Lutte contre la désinformation au Sahel : L'AES envisage la création d’une web TV | Africa Cybersecurity Magazine) (Lutte contre la désinformation au Sahel : L'AES envisage la création d’une web TV | Africa Cybersecurity Magazine).
Gabon Info, « Documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger », 06/11/2024 (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info) (Révélations chocs : Des documents secrets de la DGSE utilisés contre la France au Niger - Gabon Info).
Le Point, interview Paul Charon, « La Chine recrute aussi des influenceurs étrangers », 17/02/2024 (Chine : désinformation, manipulations et agents d’influence sur les réseaux sociaux).
CRDI, « Désinformation en Afrique : Des leçons pour l’Occident », 2022 (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international) (Désinformation en Afrique: Des leçons pour l’Occident | CRDI - Centre de recherches pour le développement international).
Wikipedia (fr), « Histoire de la CIA », section sur subversion au Chili et Brésil (Histoire de la CIA — Wikipédia) (Histoire de la CIA — Wikipédia).
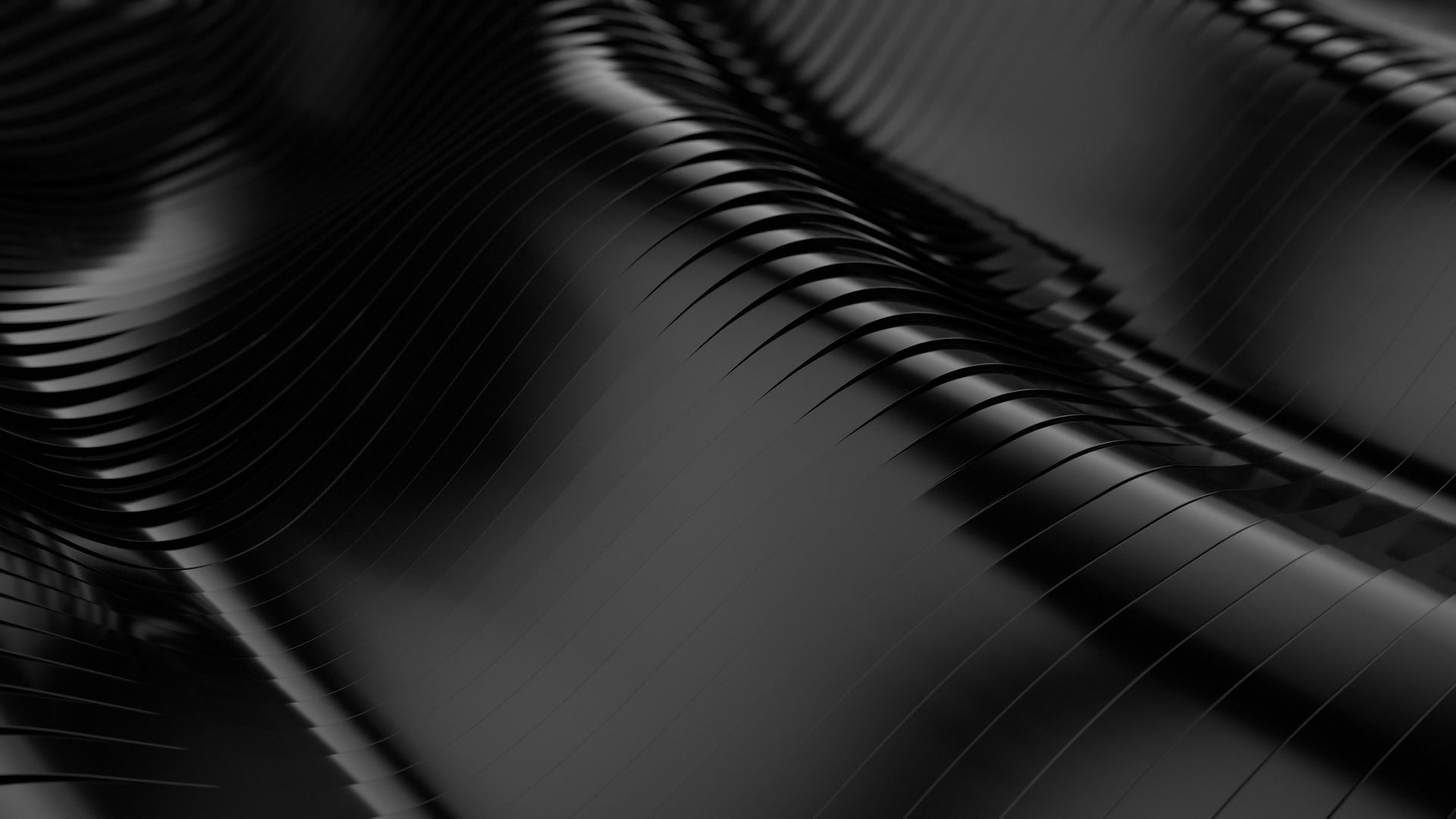
Comments